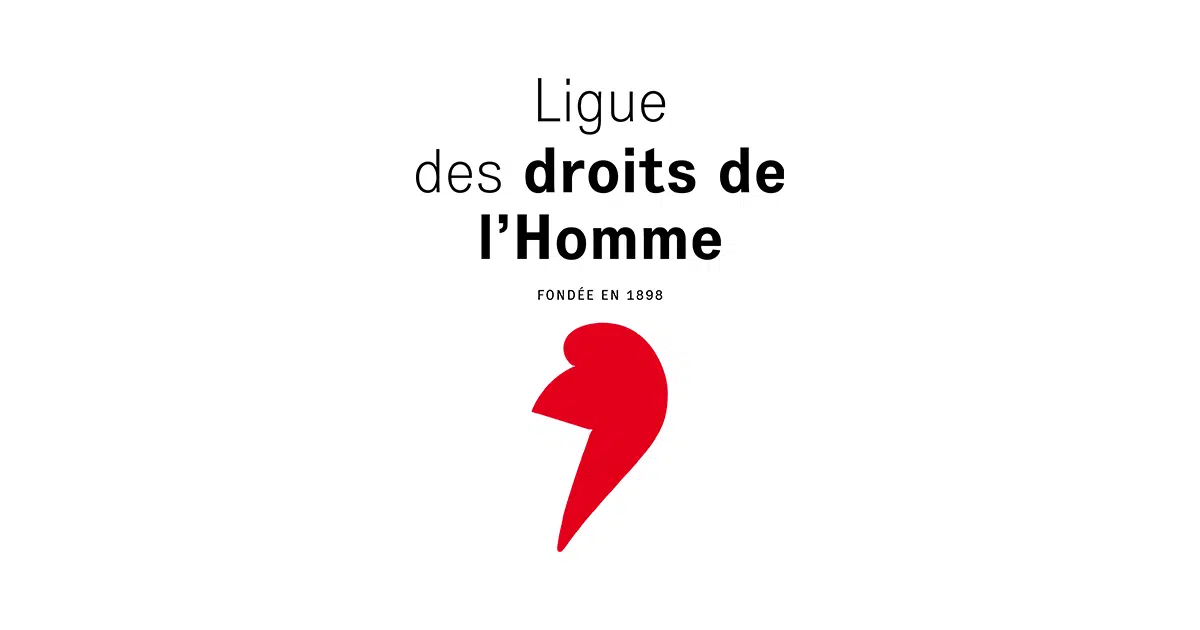Un salarié cotise obligatoirement à deux caisses distinctes, sans possibilité de choix. Les droits acquis auprès de chacune sont soumis à des règles de calcul indépendantes et rarement alignées. L’écart de traitement entre le régime général et la complémentaire peut atteindre plusieurs dizaines de points de pourcentage sur la pension finale.
La coordination entre ces deux dispositifs obéit à une logique cumulative, mais les conditions de validation des trimestres et des points diffèrent. Le transfert d’années d’activité à l’étranger ou de périodes de chômage ne produit pas les mêmes effets sur les montants servis par chaque caisse.
Panorama des régimes de retraite en France : comprendre la structure de base et complémentaire
En France, la retraite affiche une architecture à trois niveaux qui ne laisse guère de place à l’improvisation. Au premier étage, la retraite de base s’appuie sur la société sociale, pilotée par la célèbre CNAV pour les salariés du privé, la MSA pour les agriculteurs et la SSI pour les indépendants. Ce socle universel repose sur le principe de répartition : chaque génération active paie pour les retraités du moment, perpétuant une solidarité inscrite dans le marbre du système.
Impossible d’y échapper : la retraite complémentaire s’impose à tous ceux qui travaillent dans le secteur privé. Depuis la fusion Agirc-Arrco, une seule caisse gère l’ensemble des salariés, cadres compris. Ici, le fonctionnement change de décor : chaque euro cotisé se transforme en points, accumulés au fil de la carrière, puis convertis en pension. Quant aux professions libérales, elles disposent de mécanismes sur mesure, adaptés à la diversité de leurs métiers.
En troisième ligne, la retraite supplémentaire s’adresse aux prévoyants et à ceux qui préfèrent garder la main sur leur avenir financier. Plans d’épargne retraite (PER), assurance vie, PERCO : ces dispositifs relèvent de la démarche individuelle ou collective, pour compenser l’effritement progressif des régimes spéciaux depuis 2023.
Pour bien distinguer chaque étage, voici une synthèse claire :
- Retraite de base : obligatoire, gérée par une caisse nationale (CNAV, MSA…)
- Retraite complémentaire : obligatoire, gérée par Agirc-Arrco pour les salariés du privé
- Retraite supplémentaire : facultative, souscrite à titre individuel ou collectif
Le plafond de la sécurité sociale joue un rôle décisif : il fixe le cadre des cotisations et influence directement le montant des droits ouverts. Par ailleurs, les régimes spéciaux s’alignent progressivement sur le régime général pour les nouveaux entrants, marquant la fin d’une exception française longtemps défendue.
CNAV et Agirc-Arrco : quelles missions et à qui s’adressent ces régimes ?
La CNAV incarne le pilier central de la retraite de base pour l’ensemble des salariés du privé. Sa couverture ? Large, sans distinction de statut : employés, ouvriers, techniciens, cadres. Elle gère les droits, liquide les pensions et s’appuie sur les CARSAT pour assurer une gestion de proximité. La CNAV tient le gouvernail de la majorité des retraites servies en France.
Face à elle, la Agirc-Arrco supervise la retraite complémentaire obligatoire de tous les salariés du privé. Depuis la fusion de l’Agirc (pour les cadres) et de l’Arrco (pour tous les salariés) en 2019, la distinction entre cadres et non-cadres a disparu côté gestion. Le principe : chaque salarié cotise, accumule des points de retraite tout au long de sa carrière. Au moment du départ, ces points se transforment en rente, selon la valeur annuelle déterminée par la caisse.
La différence fondamentale : la CNAV pose le socle, calculé sur les trimestres validés et le salaire moyen, tandis que l’Agirc-Arrco ajoute une couche supplémentaire, appuyée sur le cumul de points. Deux systèmes, deux logiques, une même ambition : assurer un revenu après la vie active.
Voici un tableau qui résume le périmètre de chaque régime :
| Régime | Population couverte | Nature |
|---|---|---|
| CNAV | Salariés du secteur privé | Retraite de base |
| Agirc-Arrco | Salariés du secteur privé (cadres & non-cadres) | Retraite complémentaire |
L’Agirc-Arrco prévoit aussi une pension de réversion sous conditions, destinée aux conjoints survivants. Ce mécanisme s’ajoute à celui de la CNAV, renforçant la couverture des couples et créant une articulation nette entre base et complément pour les salariés du secteur privé.
Comment fonctionnent les cotisations et l’acquisition des droits dans chaque régime ?
Le financement de la retraite s’effectue à deux voix : l’employeur et le salarié partagent les cotisations. Pour la CNAV, la règle est simple : chaque euro prélevé sur le salaire brut (dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale) ouvre des droits. Les trimestres s’accumulent, au rythme maximal de quatre par an, selon le montant cotisé. Le nombre de trimestres nécessaires pour une pension à taux plein varie en fonction de l’année de naissance ; une mécanique fondée sur la solidarité entre générations.
Côté Agirc-Arrco, le système change de visage : ici, tout repose sur l’accumulation de points retraite. Les cotisations, prélevées sur deux tranches de salaire (jusqu’au plafond et au-delà), sont converties en points selon une valeur d’achat fixée annuellement. Plus le salarié cotise, plus il engrange de points, qui détermineront sa rente future. La valeur de service du point, ajustée chaque année, influe ensuite sur le montant effectivement versé.
Certains événements de la vie professionnelle ne laissent pas les salariés sur le bord de la route. Voici quelques situations qui continuent de générer des droits :
- Périodes de chômage, de maladie ou de maternité : elles peuvent ouvrir droit à des trimestres assimilés pour la CNAV ou à des points gratuits pour l’Agirc-Arrco, sous conditions.
- Périodes de service militaire ou d’accident du travail : elles sont aussi prises en compte dans le calcul des droits.
Cette organisation garantit la continuité des droits, même en cas d’interruption de carrière. Employeurs et salariés, ensemble, assurent la stabilité financière du système. Deux régimes, deux logiques, mais une solidarité qui reste la colonne vertébrale de la retraite française.
Retraite de base ou complémentaire : en quoi les modalités de calcul et de versement diffèrent-elles ?
Le décalage entre retraite de base et retraite complémentaire se manifeste dès la première simulation. La pension CNAV s’appuie sur la moyenne des 25 meilleures années de salaire, le total de trimestres retraite validés, et un taux modulé en fonction de la durée d’assurance. Si la carrière est complète, la pension atteint 50 % du salaire moyen, mais la moindre lacune se traduit par une décote. Un mécanisme transparent, sans échappatoire.
La retraite complémentaire Agirc-Arrco fonctionne, elle, sur la logique du cumul : chaque point engrangé compte, peu importe le parcours ou la progression salariale. Le montant de la pension est obtenu en multipliant le nombre total de points par la valeur du point en vigueur lors du départ. Résultat : la pension varie selon les points accumulés, sans lien direct avec le salaire de fin de carrière ou la durée totale d’activité.
Les modes de versement s’alignent sur des calendriers distincts. La CNAV paie la pension chaque mois, à terme échu, via la sécurité sociale. L’Agirc-Arrco suit le même rythme, mais la revalorisation annuelle de la valeur du point peut faire évoluer le montant perçu d’une année sur l’autre.
Pour mieux cerner les montants en jeu, voici quelques repères :
- La pension moyenne tous régimes confondus atteint 1 547 € bruts mensuels (source DREES, 2022).
- Côté Agirc-Arrco, la moyenne s’établit à 594 € pour les hommes, 315 € pour les femmes.
La pension de réversion reste accessible dans les deux dispositifs, mais chaque régime impose ses propres critères d’âge, de ressources et de calcul. Le parcours professionnel, les choix de carrière et la structure des cotisations laissent une empreinte décisive sur le montant final. C’est ce subtil jeu d’équilibre qui fait de chaque retraite un cas unique, inscrit dans la diversité des trajectoires françaises.